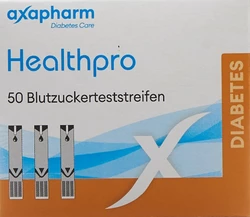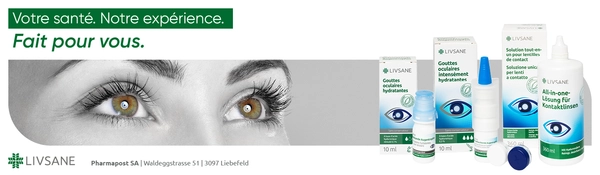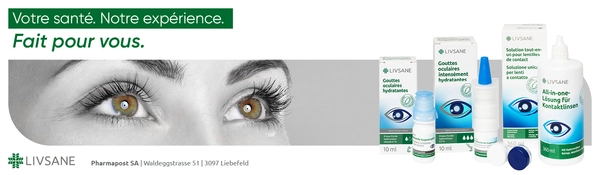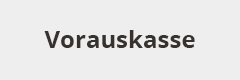Quand cela démange et tourmente tant
editorial.overview
La dermatite atopique, l'eczéma atopique : qu'est-ce que c'est ?
La névrodermite, également connue sous le nom de dermite atopique ou eczéma atopique, est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui évolue par poussées. Le terme "dermatite atopique" a été introduit au 19e siècle et est dérivé des mots grecs "neurone" (nerf) et "derma" (peau), associé au suffixe "-itis", qui signifie inflammation. À cette époque, on pensait à tort que la maladie était causée par une inflammation des nerfs, ce qui explique que son nom peut prêter à confusion.
Aujourd'hui, nous savons que la dermatite atopique est principalement causée par un dérangement de la barrière cutanée et une réaction immunitaire hypersensible. Le manteau protecteur de la peau, constitué de cellules cornées et de lipides cornés, protège normalement contre la perte d'humidité et l'infiltration de substances nuisibles, d'allergènes et de pathogènes. Chez les personnes atteintes, cette barrière est affaiblie, entraînant une peau sèche et fissurée où les allergènes et microbes peuvent facilement pénétrer. Cela déclenche des inflammations et des symptômes typiques tels que de fortes démangeaisons, des rougeurs, des desquamations et, lors des phases aiguës, des eczémas suintants.
La dermatite atopique fait partie du groupe des formes atopiques, qui inclut aussi l'asthme bronchique et le rhume des foins. Dans cette condition, le système immunitaire réagit de manière hypersensible à des substances normalement inoffensives comme les acariens de la poussière, le pollen ou certains aliments. Une inflammation de type 2 est centrale dans ce processus : le système immunitaire réagit excessivement et libère des messagers chimiques tels que des interleukines (par exemple IL-4 et IL-13), qui favorisent les inflammations et endommagent davantage la barrière cutanée. Cette cascade inflammatoire est déclenchée par des cellules immunitaires spécifiques, telles que les lymphocytes T auxiliaires 2, les mastocytes et les basophiles, entraînant ainsi un cercle vicieux d'inflammation, de lésions cutanées et d'hyper réactivité.
Il existe deux formes principales de dermatite atopique. La forme extrinsèque est la plus fréquente et se caractérise par une augmentation des anticorps IgE dans le sang, qui réagissent aux substances allergisantes. Dans ce cas, des réactions d'hypersensibilité aux acariens, aux pollens ou aux aliments peuvent déclencher une phase aiguë. La forme intrinsèque, quant à elle, présente des niveaux d'IgE normaux, et les allergies jouent un rôle moins significatif au départ. Cela dit, une réaction d'hypersensibilité peut se développer par la suite en raison d'une barrière cutanée déjà perturbée, transformant finalement la forme intrinsèque en forme extrinsèque.
Les facteurs génétiques sont également importants, en particulier les modifications du gène FLG, responsable de la production de la protéine filaggrine. Cette protéine est essentielle à la stabilité de la barrière protectrice de la peau. En cas d'absence ou de réduction de cette protéine, la peau devient particulièrement vulnérable au dessèchement et aux inflammations.
Par ailleurs, la dermatite atopique perturbe le microbiome cutané: la diversité bactérienne sur la peau diminue tandis que des germes pathogènes comme le staphylocoque doré se multiplient, aggravant ainsi l'inflammation cutanée.
La dermatite atopique débute souvent dans l'enfance et évolue par poussées avec des phases alternant entre inflammation et rémission. On ne peut pas guérir cette affection, mais un traitement et des soins adaptés permettent d'atténuer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie.
editorial.facts
- Les personnes atteintes de dermatite atopique ont un risque accru de développer également d'autres maladies allergiques comme le rhume des foins ou l'asthme. La raison : un défaut génétique de la barrière cutanée permet aux allergènes de pénétrer plus facilement dans la peau et d'irriter le système immunitaire.
- La prédisposition génétique à la dermatite atopique est irréversible. Mais grâce à l'hyposensibilisation moderne (immunothérapie spéciale), il est possible d'entraîner de manière ciblée le système immunitaire à réagir de manière moins sensible à certains allergènes. Cela peut également avoir une influence positive sur la dermatite atopique.
- Des études montrent que la dermatite atopique et d'autres maladies atopiques sont plus fréquentes chez les citadins que chez les ruraux. La raison exacte de ce phénomène n'a pas encore été élucidée de manière définitive. Les facteurs environnementaux et le mode de vie jouent toutefois probablement un rôle.
- Environ 13 % de tous les enfants développent une dermatite atopique, alors que seuls 2 % environ des adultes sont touchés. La maladie commence donc généralement dès le plus jeune âge.
- La dermatite atopique et le psoriasis (pelade) se ressemblent parfois, mais se distinguent par la répartition et le type des lésions cutanées. La dermatite atopique se manifeste souvent sur le cou, le visage et les plis des bras, tandis que le psoriasis apparaît généralement de manière symétrique sur les coudes, les genoux ou le bas du dos et forme d'autres squames.
Quels sont les symptômes de la dermatite atopique ?
La dermatite atopique se manifeste typiquement par des poussées. Cela implique qu'il existe des variations entre des phases de symptômes prononcés (poussées de dermatite atopique) et des périodes sans symptômes (rémissions). Les manifestations peuvent varier selon le stade de la maladie et l'âge des personnes touchées.
Le symptôme le plus pénible est sans aucun doute les fortes démangeaisons. Ces démangeaisons peuvent être si intenses que les personnes concernées peine à s'en débarrasser, notamment durant la nuit. La peau est souvent inflammée, rouge et gonflée, généralement localisée dans des zones typiques telles que les coudes, le creux des genoux, les poignets, le cou et le visage.
Lors des phases aiguës, des eczémas extrêmement irritants et suintants, des vésicules, des papules et des croûtes peuvent se former. Ces lésions cutanées peuvent persister pendant des jours, voire des mois, et peuvent devenir plus graves au fil du temps.
La maladie est souvent suivie d'une phase subaigüe se caractérisant par une peau sèche et squameuse ainsi que des plaques. Par la suite, la phase chronique peut persister pendant de longs mois, voire des années. En cas d'évolution prolongée ou de poussées chroniques des symptômes, la peau peut s'épaissir, devenir rugueuse et présenter de profondes fissures cutanées. Certaines zones peuvent apparaître plus claires ou plus foncées que la peau environnante.
Chez les bébés, les symptômes apparaissent généralement comme des rougeurs et des zones suintantes sur les joues et le cuir chevelu (souvent désignées comme "croûtes de lait"), suivis plus tard d'eczémas secs et squameux localisés sur les coudes, les genoux, le visage et le cou.
Chez les adolescents et les adultes, l'eczéma a souvent tendance à se développer dans le cou, le visage, les mains, l'arrière des genoux et les coudes, et peut également affecter le cuir chevelu, rendant cette zone squameuse et enflammée.
Un point important à noter est la dysfonction de la barrière cutanée, qui rend la peau sèche et vulnérable aux irritants, aux allergènes et aux infections. Ceci crée un cercle vicieux de démangeaisons et de grattage, entraînant d'autres dommages cutanés qui aggravent les symptômes.
De plus, des signes d'atopie peuvent apparaître, notamment une peau d'une sécheresse semblable à du papier, un doublement du pli de la paupière inférieure, un amincissement des sourcils et un accentuation des lignes de la main.
Que faites-vous habituellement lorsque votre peau vous démange ?
Quelles sont les causes et les facteurs déclencheurs de la dermatite atopique ?
Le développement de la dermatite atopique résulte d'une interaction complexe entre diverses causes et facteurs déclencheurs. Les principaux facteurs se répartissent en deux catégories : les causes génétiques (constitutionnelles) et les influences extérieures (environnementales).
Les causes génétiques incluent une barrière cutanée perturbée, une réponse immunitaire modifiée et une prédisposition familiale. Les personnes atteintes de dermatite atopique présentent souvent une vulnérabilité congénitale de la barrière cutanée. Cette barrière protège normalement contre la pénétration d'agents pathogènes, d'allergènes et d'autres substances nuisibles. Dans le cas de la dermatite atopique, cette barrière est compromise par des altérations de certains gènes. Cela entraîne une peau sèche, craquelée et sensible, qui perd davantage d'humidité et qui est plus perméable aux irritants et aux germes. De plus, des gènes qui régulent les réponses inflammatoires et le système immunitaire sont également impliqués. La réponse immunitaire des individus touchés est hypersensible et réagit fréquemment à des éléments environnementaux qui sont, en fait, inoffensifs. L'hérédité joue un rôle significatif dans ce contexte. Ainsi, si les deux parents sont concernés, le risque que leur enfant développe la maladie se situe entre 60 et 80 %. Cependant, il est important de noter que la dermatite atopique peut également surgir chez des individus sans antécédents familiaux.
Un autre facteur pertinent est la modification du microbiome cutané, c'est-à-dire la variété et la composition des bactéries et des champignons présents sur la peau. Dans le cas de la dermatite atopique, la bactérie Staphylococcus aureus colonise davantage les zones cutanées endommagées, évinçant les autres germes bénéfiques. Cela rend la peau plus vulnérable aux infections et exacerbe l'inflammation.
De nombreux facteurs externes peuvent également déclencher une poussée de dermatite atopique ou aggraver les symptômes. Parmi les principaux déclencheurs, on trouve les substances allergisantes, les irritants, le climat et les conditions météorologiques, les infections, le stress psychologique, les variations hormonales, les polluants, l'alcool et certains aliments.
Les allergènes les plus courants comprennent les acariens, le pollen, les poils d'animaux, les moisissures et certains aliments (notamment le lait, les œufs et les noix), mais toutes les personnes concernées ne réagissent pas aux mêmes allergènes. Les irritants cutanés se trouvent dans des produits comme les nettoyants, les savons, les cosmétiques (par exemple, parfums, conservateurs, émulsifiants) et même les produits chimiques utilisés à domicile ou des vêtements rugueux qui irritent la peau. Les températures extrêmes (froid ou chaleur), l'air sec (par exemple à cause du chauffage en hiver), une humidité élevée ou une sudation excessive peuvent aussi déclencher des phases aiguës. Des infections virales ou bactériennes (telles que des rhumes ou la grippe) peuvent aggraver la barrière cutanée, provoquant ainsi des poussées. Le stress émotionnel, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou d'autres tensions, est un déclencheur fréquent des poussées de dermatite atopique : le psychisme n'en est pas la cause, mais il joue un rôle significatif dans l'évolution de la maladie. Des variations dans l'équilibre hormonal, notamment durant la grossesse ou la puberté, peuvent également aggraver ou améliorer les symptômes. La fumée de tabac augmente le risque de dermatite atopique, surtout chez les enfants et en cas de tabagisme maternel durant la grossesse. De même, l'alcool peut irriter la peau et favoriser les inflammations. Certains aliments peuvent aussi, selon le cas d'allergie, déclencher ou exacerber les poussées.
La production fluctuante de sueur, qu'elle soit excessive ou insuffisante, contribue à aggraver les démangeaisons et les irritations cutanées. Les modifications visibles de la peau peuvent engendrer un sentiment d'insécurité, un retrait social et des problèmes psychologiques, qui, à leur tour, peuvent exacerber les symptômes.
La nuit, les démangeaisons associées à la dermatite atopique sont souvent plus intenses. Pendant la journée, on est généralement distrait par ses activités, mais une fois au repos, les démangeaisons deviennent bien plus évidentes. De plus, la chaleur de la peau pendant la nuit augmente sa sensibilité et contribue à la perte d'humidité, tandis que le frottement des draps peut également irriter davantage la peau.
Comment les médecins diagnostiquent-ils la dermatite atopique ?
Le diagnostic de la dermatite atopique repose principalement sur un examen clinique minutieux et la collecte des antécédents médicaux. Les médecins identifient la maladie grâce aux modifications caractéristiques de la peau, qui apparaissent typiquement sur des zones spécifiques du corps telles que les coudes, le creux des genoux, les poignets, le cou et le visage. Il n’existe pas de test de laboratoire spécifique pour la dermatite atopique. L'échange verbal avec le médecin permet d'évaluer l'évolution, la fréquence des poussées de symptômes, l'intensité des démangeaisons ainsi que les antécédents familiaux d'allergies ou de maladies atopiques, telles que l'asthme ou le rhume des foins. Des manifestations cutanées similaires peuvent aussi se retrouver dans d'autres maladies comme le psoriasis ou la dermatite de contact ; c'est pourquoi il est essentiel de les exclure.
Des tests sanguins visant à mesurer les niveaux d'immunoglobulines E (IgE) permettent d'identifier les allergies potentielles. En outre, des tests cutanés, incluant des prick-tests ou des tests épicutannés, sont réalisés pour détecter les substances allergisantes, comme les acariens, le pollen ou le nickel.
L'indice SCORAD est utilisé pour évaluer la gravité de la dermatite atopique et adapter au mieux le traitement. Dans certains cas, des examens complémentaires, comme des biopsies cutanées, peuvent être nécessaires pour exclure d'autres affections cutanées ou pour confirmer le diagnostic.
Que peut-on faire contre les démangeaisons en cas de dermatite atopique ?
- Prenez soin de l'ensemble de votre peau au moins deux fois par jour avec des crèmes relipidantes (par exemple, à base d'urée ou de glycérine). Il est conseillé d'appliquer de la crème immédiatement après la douche. Cela aide à retenir l'humidité dans la peau.
- En hiver, la peau nécessite des soins plus riches ; optez donc pour des crèmes plus grasses.
- Lors de l'application de crèmes et de pommades, veillez à utiliser la quantité appropriée. L'unité du bout des doigts (FTU) peut vous aider : une FTU correspond à la quantité appliquée de la première phalange jusqu'au bout du doigt (environ 0,5 gramme) et est suffisante pour couvrir environ deux paumes d'adulte. Pour le visage et le cou, on compte environ 2,5 FTU, et pour une jambe et un pied, environ 8 FTU. Appliquez généreusement la crème de manière à obtenir une couche uniforme et brillante, ce qui maximise l'efficacité du soin.
- Limitez les douches et les bains à 2-3 fois par semaine. Ne restez jamais dans l'eau plus de 5 à 10 minutes, choisissez une température tiède (max. 36 °C) et utilisez des gels douche doux et relipidants. Ceux-ci préservent la peau et ne la dessèchent pas. Les bains complets, accompagnés d'une petite quantité d'hypochlorite de sodium, peuvent également apporter un soulagement. Séchez-vous en tamponnant doucement plutôt qu'en frottant, afin de ménager la peau sensible.
- En cas de fortes démangeaisons, des compresses humides peuvent apporter un soulagement : elles rafraîchissent, soulagent et hydratent la peau. Pour les éruptions cutanées aiguës, des compresses ou des tampons rafraîchissants sont utiles.
- En cas d'allergies connues, il est impératif d'éviter tout contact avec les déclencheurs tels que le pollen, les acariens et certains aliments.
- Conservez un journal alimentaire pour déterminer si certains aliments aggravent votre peau. Il est recommandé d'éliminer un aliment uniquement en cas d'allergie confirmée, sinon vous risquez de manquer de nutriments.
- Créez un environnement sans tabac, car la fumée du tabac nuit à la santé de votre peau.
- Assurez-vous que le climat ambiant est optimal : évitez l'air sec, en particulier pendant la saison de chauffage, et utilisez un humidificateur pour maintenir l'humidité entre 40 et 60 %. Aérez fréquemment pour réduire la formation de moisissures et de substances nocives dans l'air, protégeant ainsi votre peau d'une sécheresse et d'une irritation supplémentaires.
- Évitez le soleil direct et protégez-vous avec un écran solaire à indice de protection élevé (au moins SPF 20).
- Privilégiez des vêtements doux et respirants. Des tissus comme le coton ou le lin sont idéaux, tandis que la laine et les matières synthétiques doivent être évitées. Les vêtements doivent être amples. Lavez toujours les nouveaux vêtements et enlevez les étiquettes irritantes.
- Pour les personnes allergiques à la poussière domestique, il est judicieux d'utiliser des housses anti-acariens pour le matelas et l'oreiller. Gardez vos chambres à coucher fraîches, avec une température maximale de 20 °C, afin de prévenir la transpiration nocturne.
- Coupez vos ongles courts pour éviter de vous blesser en vous grattant. Envisagez de porter des gants en coton la nuit, particulièrement pour les enfants, afin de prévenir les lésions dues au grattage.
- Pour les inflammations aiguës, des crèmes contenant de la cortisone peuvent être appliquées de manière ciblée sous la supervision de votre médecin. Des crèmes anti-inflammatoires sans cortisone (inhibiteurs de calcineurine) peuvent également être proposées en alternative, notamment pour les zones cutanées sensibles.
- En cas d'infection cutanée, des soins antiseptiques, antifongiques ou antiviraux sont très utiles.
- Les antihistaminiques peuvent soulager les démangeaisons, mais ils doivent être utilisés sur avis médical.
- La luminothérapie (UVB/UVA1) peut être utile en cas d'évolution grave et chronique, mais seulement sous contrôle médical.
- Une thérapie systémique avec des médicaments comme la ciclosporine, le méthotrexate, l'azathioprine ou le dupilumab est envisagée pour les cas graves et, là encore, sous contrôle médical.
- Concevez votre alimentation de manière consciente. Incluez beaucoup de fruits et légumes frais, ainsi que des produits à base de céréales complètes dans vos repas et veillez à une hydratation adéquate.
- Évitez les produits de nettoyage et de soins contenant des parfums ou des conservateurs, car cela peut aggraver les irritations cutanées. Optez pour des adoucissants sans parfum et veillez à rincer soigneusement les vêtements.
- Limitez les activités sportives qui entraînent une transpiration excessive, car cela peut irriter la peau. À la place, préférez des exercices doux comme le yoga, ou des techniques de relaxation telles que la méditation et la relaxation musculaire progressive. Une activité comme le vélo ou des promenades en plein air est également bénéfique pour rester actif tout en préservant votre peau.
- Recherchez un soutien psychologique si nécessaire. Une aide professionnelle peut être très utile lorsque l'état de santé est particulièrement éprouvant. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous détendre et profitez de petites joies et activités apaisantes.
La dermatite atopique est bien plus qu'une simple maladie de peau, car elle impacte non seulement le corps, mais aussi l'esprit et le bien-être général. Malgré les défis que posent les éruptions cutanées récurrentes et les démangeaisons intenses, il existe de plus en plus de solutions pour les personnes touchées, leur permettant de protéger leur peau, de soulager leurs symptômes et d'améliorer leur qualité de vie. Il est essentiel d'écouter les signaux de son corps pour trouver sa propre voie vers un plus grand apaisement cutané.